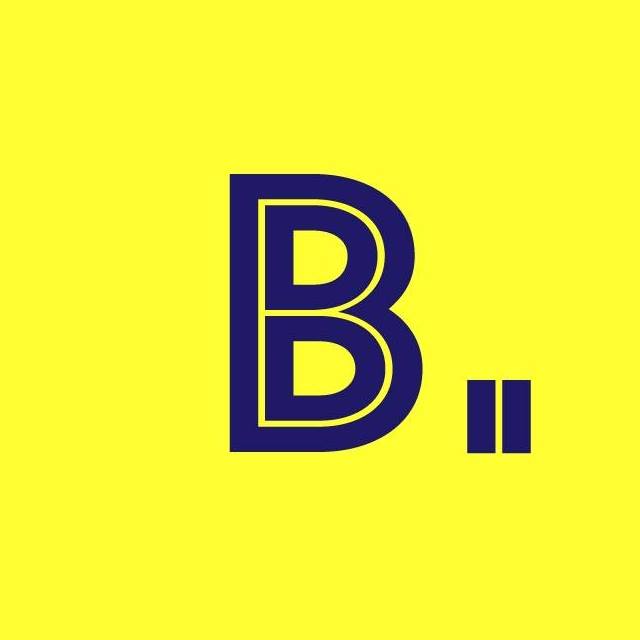Steve Jobs : de l’Inde au Zen
En 2018, Apple et Amazon ont franchi la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce chiffre donne une idée de la puissance de l’empire numérique et du poids d’Apple dans l’extension des technologies de guidance généralisée. L’œuvre du cofondateur de la marque à la pomme (Steve Jobs) a consisté à révéler l’unité profonde de l’être humain et de la technique. Il y est parvenu en conciliant une démarche intérieure et une action industrielle vouée à rapprocher les technologies de facilitation au plus près de l’être humain.
L’accomplissement de l’homme
Steve Jobs envisageait l’ordinateur comme « l’outil le plus remarquable que l’homme ait jamais construit. C’est l’équivalent, disait-il, d’un vélo pour l’esprit ». La métaphore laisse deviner le pouvoir libérateur accordé à la technique. Aujourd’hui, les géants du numérique rêvent d’amplifier les interactions entre les êtres humains et les réseaux artificiels de sorte à soulager les sociétés humaines de nombreuses servitudes. Cet élan doit beaucoup à notre consentement, à notre fascination pour les nouvelles technologies et les facilités qu’elles permettent. Parler de mysticisme technologique revient à considérer la technique comme étant l’accomplissement de l’homme.
L’expérience indienne
Après sa lecture de l’Autobiographie d’un yogi de Paramahansa Yogananda et sa fréquentation du mouvement Hare Krishna, Jobs séjourne sept mois en Inde dans le but d’étudier les sagesses indiennes. On est en 1974. Il se rend dans le Nord du pays dans l’espoir de rencontrer Neem Karoli Baba, un saint connu pour son immense compassion. Malheureusement, Neem Karoli Baba est décédé en septembre 1973. À l’ashram Kainchi Dham, Jobs découvre la mystique indienne sous la forme de la voie de la dévotion et de la tradition des chants (« kirtans ») qui l’accompagne. Son expérience indienne sera déterminante dans son parcours.
S’inspirer du Zen
De retour aux États-Unis, il réalise les limitations du mental et de la pensée rationnelle. Très marqué par son expérience du LSD, il soutient l’idée qu’on peut réussir sa vie sans être conformiste. Il adhère au parti libertarien, un mouvement antiétatique qui place la liberté individuelle au centre de son projet politique et rejette toute forme d’interventionnisme de l’État.
Jobs s’engage également dans l’école Sôtô, la principale école du bouddhisme Zen. Il se rapproche de Shunryu Suzuki Roshi à l’origine du Zen Center de San Francisco. « Le Zen ne s’intéresse pas à la compréhension philosophique, écrit Shunryu Suzuki (1). C’est la pratique qui compte. » L’approche abrupte de l’école Sôtô correspond bien au tempérament de Jobs. Il médite depuis son adolescence et suit un régime alimentaire drastique. Le désintérêt du Zen pour la compréhension philosophique se marie bien avec un profil économique et managérial fondé sur la politique du résultat et l’efficience professionnelle.
L’incidence du Zen sur les milieux industriels va être considérable. C’est d’ailleurs à se demander si certaines formulations zen n’ont pas été détournées à des fins de motivation personnelle. Je pense en particulier à l’affirmation : « Quand vous croyez en votre voie, l’illumination est là » (2). Formule que l’on peut transformer en un adage du développement personnel : « Quand vous croyez en vous et/ou en votre entreprise, la réussite est là ».
À la fin des années 70, le Zen a pénétré les universités. Des cursus de management intègrent l’approche du Zen pour stimuler la créativité dans les affaires. C’est le cas à l’université Stanford à San Francisco où Steve Jobs fait un discours mémorable en juin 2005. Relatant son expérience du cancer, il incite les étudiants à développer une conscience continue de l’impermanence et de la mort. Selon lui, cette conscience accrue favorise des dispositions mentales essentielles pour stimuler l’audace d’entreprendre. On trouve justement dans les enseignements bouddhistes l’idée d’une urgence à s’accomplir du fait de notre état transitoire.
Beauté et simplicité
Ceux et celles qui ont vu les présentations de Steve Jobs et ont entendu parler du Zen reconnaissent dans les diapositives du cofondateur d’Apple quelques principes zen relatifs à l’esthétique et à l’équilibre. Il y ajoute sa connaissance de la typographie. Sur scène, quand il présente un nouveau produit, Jobs combine la modération dans la conception des écrans, le minimalisme des visuels, l’efficacité, la clarté et le naturel dans l’exposé oral. Il applique ainsi une notion centrale japonaise nommée « wabi », la beauté de la simplicité. Le succès d’Apple doit beaucoup à la mise en œuvre industrielle de ce principe. Lignes épurées, ergonomie immersive, fluidité de l’expérience utilisateur, sobriété du design et élégance des formes incarnent la quête d’une perfection matérielle, l’esquisse d’un paradis possible où la technologie se ferait l’écho de la beauté du monde. C’est ainsi que les Mac, iPhone et iPad sont devenus des objets cultes.
En adaptant certains codes du Zen au marketing et aux produits de la marque, Steve Jobs essaye d’incarner dans le monde de l’entreprise une façon de voir la vie et une manière d’être propres au Zen.
La quête de la beauté plastique et de la simplicité va de pair avec la vision extrême orientale de la nature. La nature est ce qui s’autoproduit spontanément, sans intention, sans objectif. La nature étant une et entière, l’homme n’est pas extérieur à « ce qui est ainsi de par soi-même ». Vision que l’on retrouve dans les enseignements du Zen Sôtô. Dans ce contexte, un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable ne vont pas contre l’écoulement des choses. Les efforts consentis au niveau du design visent aussi à « humaniser » les technologies pour en faire des « objets naturels ».
Ainsi, en adaptant certains codes du Zen au marketing et aux produits de la marque, Steve Jobs essaye d’incarner dans le monde de l’entreprise une façon de voir la vie et une manière d’être propres au Zen. Son aura est telle que le lendemain de son décès, Le Monde des Religions relate « la mort d’un dieu moderne » (3). « Prophète », « messie », « guru », différents qualificatifs religieux ou spirituels sont alors associés à la personnalité de l’entrepreneur.
Rendre le monde meilleur
Mentor de Mark Zuckerberg, Steve Jobs conseille au patron de Facebook de se rendre dans la péninsule indienne et de passer quelque temps dans l’ashram de Neem Karoli Baba. Cet ashram devient un lieu de pèlerinage pour bon nombre d’entrepreneurs de la Silicon Valley, dont Larry Page, cofondateur de Google. En 2015, dans un dialogue public avec le Premier ministre indien Narendra Modi, Zuckerberg révèle qu’il a suivi les conseils de son mentor. En 2008, il séjourne à l’ashram où vécut le saint indien. Il réalise alors que « le monde pourrait être meilleur si les gens étaient plus réellement connectés », dit-il à Narendra Modi. On trouve dans ses propos l’énoncé récurrent de la mission que s’assignent les géants du numérique : œuvrer pour un monde meilleur ; relayer ce que Steve Jobs affirmait 25 ans plus tôt lors d’une intervention sur le marketing d’Apple : « La valeur centrale d’Apple, disait-il, repose sur le fait que nous croyons que des gens passionnés peuvent changer la face du monde en le rendant meilleur ».
Constat
Cette vision demeure idéaliste. Sous la coque en aluminium des artefacts technologiques vibre l’énergie immémoriale de la Terre. La présence des matériaux précieux et des métaux rares résulte de la dévastation d’un grand nombre d’écosystèmes. Le numérique essaie aussi de s’ériger en culture en vantant l’intelligence pratique au détriment de l’intelligence réflexive. Avec le déploiement illimité des systèmes d’intelligence artificielle, la banalisation du « tout numérique » et l’exigence d’adaptation aux mutations continues, la vie dans son ensemble devient technique. Les traditions bouddhistes perdraient leur authenticité en se « technicisant » et en cédant aux penchants scientifiques. On en trouve les prémisses dans le couplage des sciences cognitives et des pratiques de méditation ou dans la volonté d’assimiler le bouddhisme à une « science de l’esprit ». Face au système technicien, fondé sur la certitude de l’émancipation ultime de l’homme par la technique, les enseignements du Bouddha nous invitent encore à trouver en nous-mêmes les ressources indispensables à la transformation de soi.