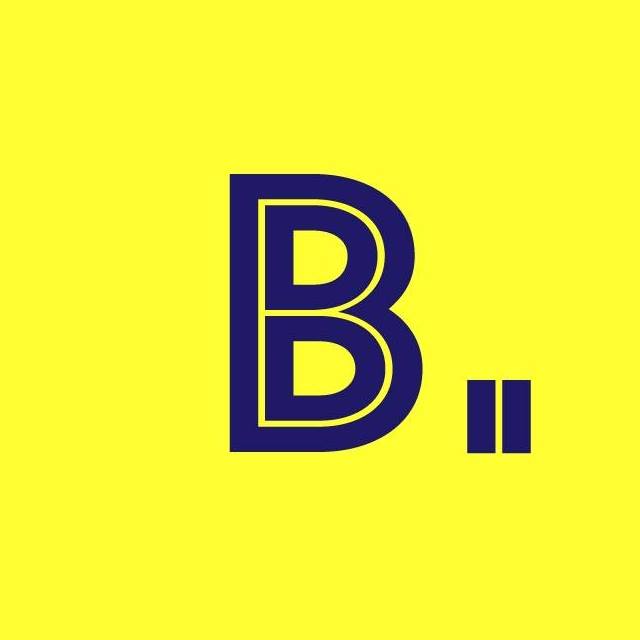Vénérable, avez-vous été élevé dans une famille très pratiquante ?
Je suis né à Vientiane au Laos, derrière la pagode du village, où j’ai été ordonné il y a plus de cinquante ans. Tous les matins, mes parents donnaient des offrandes de nourriture aux moines qui mendiaient des aumônes comme le veut la tradition. Le temple étant juste en face de chez nous, j’ai donc grandi au contact des moines et des novices. Je suis parti ensuite faire des études d’ingénieur aux États-Unis et en Angleterre. À cette époque, j’étais un étudiant parmi d’autres, je m’intéressais aux Beatles, aux Rolling Stones et au football, jusqu’au jour où je suis tombé amoureux d’une princesse laotienne. Au Laos, la tradition veut qu’à vingt ans, vous fassiez dix-huit mois à deux ans d’armée, ou trois mois de retraite spirituelle pour obtenir un « certificat de bonne conduite » et pouvoir vous marier. Pour avoir ma « green card » en quelque sorte, afin d’être reconnu comme adulte et pouvoir l’épouser, j’ai dû faire cette retraite. C’est alors que j’ai eu la chance de rencontrer un maître très réputé de l’école de la forêt, Ajahn Pan Anando. Il m’a aidé à aller à l’essentiel, me disant que je n’avais rien à apprendre, simplement à aller pratiquer dans une cabane de méditation, dans la forêt, pendant ces trois mois. Cette période achevée, il a ajouté : « Vous avez intégré la base, mais est-ce suffisant ? Une fois marié, vous serez trop occupé pour continuer, alors que là vous êtes encore libre d’apprendre. » Cela m’a touché, et je suis resté au monastère. Mon maître décéda un an plus tard. En tant que moine, avec d’autres disciples, notre devoir étant de nous occuper de ses funérailles, je suis resté sur place jusqu’à ce que la situation politique m’oblige à quitter le pays.
Comment êtes-vous arrivé en France ? Par choix politique ?
Je suis d’abord parti en Thaïlande pour suivre les enseignements d’Ajahn Chah (1), qui était déjà très connu. En 1975, le Laos est devenu la République démocratique populaire, je ne pouvais pas y retourner. Tous les Laotiens qui avaient reçu une éducation occidentale étaient conduits dans des camps de rééducation. Alors, Ajahn Chah m’a dit : « Votre place est en France ». C’est ainsi que je suis devenu le premier moine réfugié en France, en juillet 1975. Un petit cousin de douze ans m’accompagnait. Quand nous sommes arrivés, sa sœur qui faisait ses études à Paris m’a dit : « Je le prends avec moi, mais je ne peux pas vous héberger ». Elle habitait dans une petite chambre mansardée sous les toits. Il n’y avait pas encore de camps de réfugiés, pas d’accueil organisé à l’époque. Je me suis donc retrouvé seul, vagabond à Paris, avec les clochards, pendant un an.
Certains étaient d’anciens professeurs, d’anciens cadres et parlaient anglais. Comme je ne buvais pas d’alcool, je suis devenu leur barman, je gardais leurs bouteilles pendant qu’ils allaient chercher à manger, et en échange, ils me donnaient des restes de nourriture. Je suis devenu en quelque sorte le concierge de tous les clochards des XIIIe et XIVe arrondissements de Paris. J’ai appris beaucoup de choses au contact des SDF. Quand ils étaient sobres, nous pouvions échanger, mais quand ils s’adonnaient à la drogue ou la boisson, c’était impossible. Souvent, au début de leur désocialisation, il y avait un licenciement, une dispute avec un conjoint, une séparation… Quand on arrive dans la rue, il est rare de pouvoir retourner en arrière, l’esprit se brouille, les moments de lucidité sont trop brefs pour reprendre pied. Pourtant, si les conditions sont favorables, il est toujours possible de changer, à condition de trouver un endroit où se stabiliser physiquement, et de rester loin de certaines influences négatives. Quand nous touchons le fond, il n’y a que deux possibilités : se noyer ou remonter à la surface. Certains réussissent à reprendre pied, d’autres non. Pour les addictions, il faut aller encore plus loin et consolider le mental, le physique et le psychique, car soit on meurt, soit on s’en sort. Le bouddhisme enseigne que nous sommes responsables de nos paroles, de nos pensées, de notre bien-être et de nos malheurs. On ne peut donc pas accuser la société, la famille ou un autre de notre souffrance.
Quand j’étais auprès d’eux, je pratiquais matin, midi et soir. Certains essayaient de faire pareil et restaient immobiles, sans parler. D’autres me demandaient ce que je faisais, mais nos échanges étaient très réduits. Pendant quelques années, j’ai gardé des liens avec ceux qui sont venus me voir à Tournon, pour apprendre à méditer. Aujourd’hui, la plupart sont morts… Quand il n’y a plus rien, plus d’espoir, plus de clarté, qu’il n’y a même plus conscience du danger, alors la mort arrive parfois plus vite.
Tournon a été un tournant. De la rue à la création du monastère en France, votre parcours est étonnant, qu’en retenez-vous ?
Pour pouvoir enseigner et pour comprendre le monde autour de moi et la complexité de la société française, j’avais besoin de temps. En quarante-trois ans, beaucoup de choses ont changé dans la société. Petit à petit, des choses ont évolué, avec les mères célibataires, le concubinage, le Pacs, puis le mariage pour tous, c’est toute la société qui a bougé. Le couple est un bon indicateur de l’évolution des sociétés, l’éducation des enfants aussi. Alors, bien sûr, ces changements déstabilisent les conservateurs, mais pour nous bouddhistes, c’est une évolution normale, puisque tout est impermanent. La société évolue, les lois aussi, les gens aussi. Ce n’est ni bien ni mal. C’est l’adaptation. On tire des leçons de nos expériences.
Les familles recomposées sont un challenge pour le monde moderne. Les anciennes notions de frère, de sœur, de père, de mère se transforment. C’est pourquoi la leçon d’une génération n’est pas valable pour la génération suivante. Il faut l’accepter, c’est cela l’enseignement. Si on le refuse, on reste bloqué et l’énergie ne circule pas.
Nous sommes sur Terre pour apprendre à vivre avec ce que l’on a, ce que l’on est, et à nous adapter au milieu, à l’environnement social, aux circonstances. Le but est de se libérer de la souffrance. Mais comment éradiquer la souffrance pour trouver la paix intérieure et vivre en harmonie ? La première étape, « la moralité », consiste à faire attention à ce que l’on dit, ce que l’on pense, ce que l’on fait. Il s’agit ensuite de s’efforcer de maintenir cette attitude de plus en plus longtemps : c’est la clarté mentale, la concentration et la méditation. Et, quand on parvient à établir, au quotidien, sans interruption, cette zone de paix, cet état de clarté et de bien-être, de laisser la sagesse se manifester. Si on relâche cette attention, tout retombe ; si on la maintient, cela se stabilise. Acquérir cela n’est pas inné. Contrairement à ce que pensent certains Asiatiques, ce n’est pas parce qu’ils sont nés bouddhistes qu’ils le sont. Non, le bouddhisme est un état d’éveil qui permet une prise de conscience qui aide à vivre dans ce monde en folie. Etre bouddhiste, ce n’est pas simplement réciter des prières ou des mantras.
Pourquoi le bouddhisme est-il adapté à notre époque et à la société actuelle ?
Parce qu’il responsabilise et permet de s’ajuster à toutes les situations, et de trouver les causes des problèmes, de la souffrance, de la maladie, de l’inconfort… Il y a un problème, alors il y a une cause ; et s’il y a une cause, il y a une solution. C’est ce qu’expriment les Quatre Nobles Vérités du bouddhisme. La première dit que l’existence est porteuse de souffrance ; la deuxième, qu’il y a des causes à l’origine de toute souffrance ; la troisième, qu’il existe un remède à cette cause ; et la quatrième, qu’il y a un chemin menant à la libération de la souffrance et au bien-être – par l’observation de la probité, de la concentration et de la sagesse.
« Le bouddhisme est un état d’éveil qui permet une prise de conscience qui aide à vivre dans ce monde en folie. Etre bouddhiste, ce n’est pas simplement réciter des prières ou des mantras. »
Le bouddhisme est humaniste et moderne. Ce qui implique que ceux qui le suivent développent le sens des responsabilités et apprennent à s’adapter. S’adapter signifie être prêt, ne pas dépendre des circonstances, quoi qu’il arrive. La société actuelle n’est pas assez indépendante, elle doit travailler à parvenir à l’autosuffisance. Il y a des choses simples et importantes à faire pour cela, comme un petit jardin pour se nourrir, car la nourriture est le premier médicament. En ville, on peut faire un petit potager sur son balcon. La base, c’est la nourriture, pour la santé et l’équilibre, le mieux est de consommer des aliments naturels. Il est aussi essentiel de garder un contact avec la terre, la nature. Le bouddhisme apprend à vivre en harmonie avec soi-même et avec son environnement. Si chez vous, vos plantes ne vont pas bien, c’est que votre appartement n’est pas « sain », c’est un peu comme un test…
Le bouddhisme peut également apporter des réponses aux enjeux actuels, à la bioéthique par exemple. Il est important de laisser partir naturellement les mourants. S’il y a la possibilité de les soigner, alors oui, il faut les soigner, sinon il faut les laisser s’éteindre. Nous sommes des humains, dominés par la peur, le désir, le rejet et l’ignorance, nous n’intervenons pas toujours à bon escient. Autre exemple, celui du cannabis utilisé dans les soins. Il atténue certaines souffrances, mais il a aussi parfois des effets néfastes. La méditation permet de trouver naturellement un état de joie, de paix et surtout d’être en contact avec la réalité, avec la nature et avec notre nature humaine, alors, oui, il faut méditer.
Vous partagez vos connaissances avec des peuples très différents, comme lors de vos voyages en Amazonie. Comment les avez-vous rencontrés ? Sur quels plans vous retrouvez-vous ?
En 2011, en Inde, à l’occasion des 2600 ans de l’Éveil du Bouddha, cinq mille moines ont été invités à planter l’arbre de l’éveil, un pipal, un ficus religiosa, à New Delhi dans le parc de Gandhi. Au même moment, en Amazonie, des chamanes du peuple Yawanawa, qui venaient de terminer des rituels purificateurs, ont eu la vision de « têtes rasées » sortant de leur forêt. Comme ils n’étaient jamais sortis de chez eux, sur le moment, ils ne comprirent pas de quoi il s’agissait. Jusqu’au jour où ils ont été invités à venir parler de la protection de la nature à l’Unesco et qu’ils m’ont vu, je faisais partie de ces « têtes rasées »… Ils m’ont ensuite invité en Amazonie. Sur le plan spirituel, ils me reconnaissent comme chamane. Pour eux, je suis en quelque sorte une antenne, un relais, qui les aide à se connecter à des énergies subtiles, ils m’ont demandé d’apprendre aux jeunes chamanes des méthodes de purification de l’esprit, pour qu’ils aient des visions claires, spontanées, sans l’aide de substances hallucinogènes, telles l’ayahuasca et autres poudres de perlimpimpin, qui, contrairement au bouddhisme, provoquent des états non conscients, de transe, dépourvus de clarté de l’esprit. Avec ces chamanes, je partage les mêmes bases. Eux aussi ont appris à survivre seuls dans la forêt, protégés des dangers grâce aux pratiques sur l’esprit. Quand un danger survient, ils sont prêts, car en réalité, le danger est en nous, non à l’extérieur. Quand on est clair et éveillé, il n’y a pas de peur. Un moine de la forêt ne fuit pas devant la peur. Soit il reste immobile, soit, s’il en a le courage, il avance vers l’inconnu, vers la « bête » qui est en lui. Il n’y a ni à accepter ni à rejeter la peur, car tout est illusion, et c’est nous qui la créons. Il y a juste à observer sa venue et à anticiper ses effets.
Que vous a apporté le fait de vivre en France sur le plan de la compréhension du dharma et la pratique ?
La découverte de l’évolution de la société à travers le mariage, le Pacs et cette dernière étape du mariage pour tous. C’est excellent de voir les choses évoluer et de les accepter. Il y a aussi tous ces changements autour du masculin et du féminin, et maintenant le troisième sexe… J’attends pour savoir quelle sera la prochaine étape !