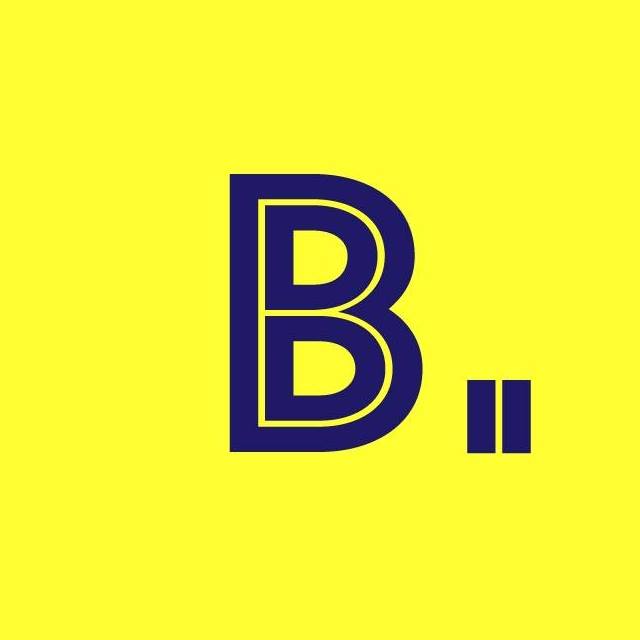Samedi 6 juillet 2019. Alors que les juilletistes prennent d’assaut les autoroutes des vacances, j’ai choisi de voyager sur la Voie (pas vraiment expresse) du Zen, un chemin certes plus long, mais sans bouchons. Direction la Falaise Verte, à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche. Non, ce n’est pas un énième camping longeant la rivière l’Eyrieux, mais le centre Zen Rinzaï dirigé par maître Taïkan Jyoji. Vingt hectares de verdure dans les monts du Vivarais, qui abritent un complexe comprenant une bâtisse en pierres de taille, un réfectoire, un zendo (consacré par maître Kohno Taitsu en 2010) et le Dojo de l’Esprit Direct, inauguré en 1988 par une délégation de soixante kyudokas (archers) et senseïs japonais. C’est là que je vais passer six heures par jour à tenter de mettre dans le mille sans provoquer d’accident.
Ne suivez pas la flèche
Le kyudo, kezako ? Le tir à l’arc ancestral nippon, plus connu sous le nom de « Voie de l’arc » ou « Zen debout ». Bien plus qu’un sport, « il convient d’envisager le Kyudo non pas comme le simple maniement de l’arc et de la flèche, mais comme une méditation, un long cheminement conduisant à une maturation, à un mûrissement de l’individu, à une élévation de la conscience », précise l’exposé de la Falaise Verte. Une question me taraude : n’est-il pas dangereux de confier une telle arme à un esprit tortueux ? D’emblée, maître Taïkan Jyoji m’explique que c’est l’inverse : la mire n’est pas celle que l’on croit. Ici, on se moque du « bullseye », seule importe la lente mécanique de ce tir de précision intérieure, qui se décompose en huit phases consécutives, appelées hassetsu. N’en déplaise aux apprentis Guillaume Tell, décocher une flèche n’est pas du gâteau : tendre la corde de l’arc, gérer sa tension avec relâchement, tenir la position sans se raidir, libérer sa flèche sans trembler, et tout cela en mettant son cerveau de côté pour justement ne pas mettre à côté… En trois jours de kyudo, ça a été la cata, rien n’est sorti de mon yumi (arc)… Mais comme me le rappelle le maître, là n’est pas l’essentiel, je suis la réelle cible de ce tir.
Autour de moi, une vingtaine de stagiaires de tout âge et tout horizon, collectionnant les dan (grades), décoche des flèches à la vitesse d’un escargot. Muscles tendus, regards droits, en soi, muets et en rang d’oignons, ils livrent leurs propres batailles. Drapée dans son keikogi blanc (sorte de kimono d’entraînement) et son hakama noir (pantalon large plissé), Heini, une discrète sexagénaire suédoise, pratique cette discipline depuis cinq ans. La compétition ne l’intéresse pas, « le kyudo est un art du non-ego, il nous apprend à travers tous ses rituels à nous libérer des pensées qui nous assaillent et de tout ce qui nous entrave au quotidien. Par la maîtrise des gestes, le kyudoka recherche un mouvement parfait pour pouvoir transcender à la fois son corps et son esprit », résume-t-elle.
Les mystères de l’Est
Pour éviter de patiner dans le vide, les figures sont imposées. Chaque geste, millimétré, minuté à la seconde près, fait partie d’un ensemble méticuleusement chorégraphié et requiert une attention profonde. Il faut suivre à la lettre une mécanique huilée, ritualisée, voire rébarbative pour ceux qui n’ont jamais pratiqué un art martial. Mais pour Jonathan, kudyoka lyonnais de 43 ans et habitué du stage, suivre la règle est la condition sine qua non pour atteindre non pas le mato (la cible située à 28 mètres, ou la makiwara, botte de paille d’échauffement à portée d’arc), mais son objectif : « Certes, le kyudo est un art extrêmement cadré, mais avec un espace de liberté à l’intérieur. »
Toutes ces phases – le salut en rentrant dans le dojo, l’élévation de l’arc au-dessus de la tête (uchiokoshi), la libération de la flèche (hanare), etc. – constituent des passages obligés. « En les suivant scrupuleusement sans se poser de questions, on se concentre uniquement sur le moment présent, conformément à l’enseignement de la non-pensée du Zen », ajoute-t-il. Lui le blagueur, si jovial au quotidien, rentre dans une bulle infranchissable, une sorte de champ de force zen, lorsqu’il pénètre dans le dojo. Comme Jonathan, les autre kyudokas ont adopté le respect de l’étiquette (rei) et le goût de l’esthétique japonaise, ces postures droites et rigides des samouraïs. Certains détaillent le fameux zanshin (littéralement « l’esprit se poursuit »), soit l’esprit du geste, d’autres, comme William, un étudiant marseillais, préfèrent décomposer les mouvements plutôt que de les décrypter. Formuler, intellectualiser, est une mauvaise habitude occidentale ; à la Falaise Verte, véritable îlot japonais, le soleil se lève et se couche à l’Est.
« Réaliser sa nature profonde, ce n’est pas de la rigolade. » Maître Taïkan Jyoji
Sous l’œil du maître du dojo, les entraînements de kyudo se déroulent en deux temps : une première partie consacrée au « sharei » (ou tir de cérémonie), effectué en groupe selon un strict protocole, avant une session de tir libre, durant laquelle chacun pratique à son rythme. Au bout de deux heures d’entraînement, c’est le repos des guerriers. Étrangement, après ma première séance, je ne ressens aucune fatigue ni douleur, mais une énergie apaisée. Oui, le kyudo, ça calme.
Coups de balai et ballet des kyudokas
Je suis l’un des deux seuls bizuths du stage, ce qui me vaut quelques regards compatissants puisque durant cette plongée intensive, tous les poisons qui font parfois le sel de l’existence (cigarettes, alcool, téléphones portables, connexion wifi, etc.) sont proscrits. Comme le rappelle maître Taïkan Jyoji, « la transformation de soi, ce n’est pas de la rigolade ». Ce n’est pas faux, la preuve : lever à 6h40 du matin au son non pas du clairon mais d’une clochette, pour une demi-heure de zazen. Un rapide petit-déjeuner dans la foulée, puis nous sommes réquisitionnés pour le « samou », des travaux d’intérêt général pour prendre conscience de sa place au sein du collectif. Au choix : entretien du potager, coupe des légumes, creusement d’une tranchée pour la plomberie, nettoyage des sanitaires et autres corvées salvatrices. Sans oublier le désherbage du jardin zen (25 mètres de long sur une dizaine de large), recouvert de feuilles mortes, sur lequel il faut avancer en crabe dans les sillons de cailloux sans les aplatir. Pieds plats s’abstenir. Après une heure et quart de travaux pas forcés, place à deux heures de kyudo. Puis déjeuner végétarien pris dans des bols que le stagiaire nettoiera à l’eau chaude et au doigt avant de les empaqueter dans sa serviette, qu’il rouvrira le soir et les jours suivants. Tous les repas se déroulent de la même manière : chacun à la même place, face à ses bols, dans le silence absolu et en pleine conscience. Pas question de tailler le bout de gras, les bols sont vite avalés. Reprise des activités à 15 heures pour une nouvelle séance de kyudo, puis un atelier de hitsuzendo (calligraphie ou « Voie du pinceau zen »), suivi du dîner à 18h30 et d’une dernière session nocturne de tir libre. Extinction des feux à 22h30.
Durant mon immersion, le temps est à l’orage, la météo alterne chaleurs étouffantes et pluies diluviennes, sans déranger le ballet des kyudokas. Ce stage est une traversée de soi, menée à un tempo pianissimo, mais pas de croisière. Si l’atmosphère est au recueillement, elle n’en est pas moins bon enfant. À l’image du maître, inflexible mais bienveillant, chaque stagiaire semble à l’écoute de soi et, par ricochet, au soutien de ses voisins. Imaginez une colonie de vacances sans moniteurs et pour seul directeur un maître zen.
Tendre, détendre. À l’image de la corde, mes émotions font le yoyo au fil des journées, je pense tout quitter dès le deuxième jour, mal à l’aise dans cet univers spartiate ; mes pensées filent à la vitesse du TGV vers mon cocon parisien. Mais je repense à cette phrase du maître qui m’expliquait en début de stage que « réaliser sa nature profonde, ça ne se fait pas dans la crème fouettée ». Le lâcher-prise est le seul plat à la carte des kyudokas, et c’est en soi un festin.