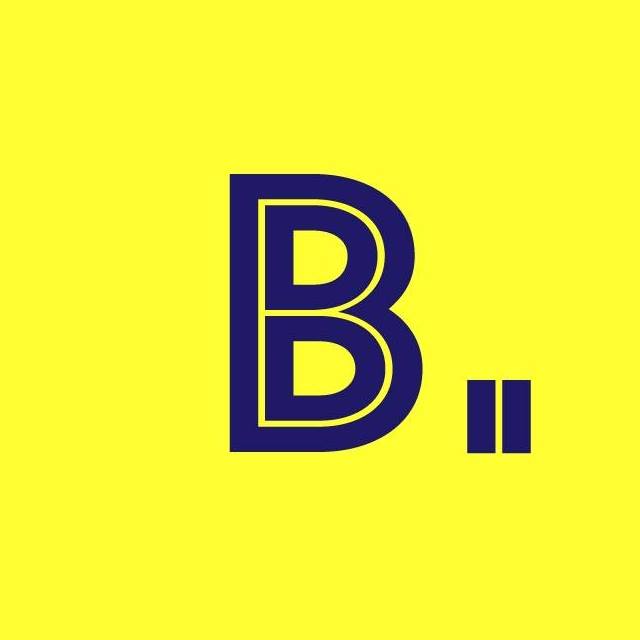Très jeune, vous avez œuvré au service des plus pauvres dans les bidonvilles autour de Saïgon. Comment est née cette volonté de vous engager si tôt sur le terrain social ?
J’ai toujours voulu aider les autres, et ce, dès mon plus jeune âge. Peut-être était-ce lié au fait que j’avais été nourrie, étant enfant, par les paroles de mon grand-père paternel, très respecté dans sa communauté, qui ne cessait de répéter à ses petits-enfants : « Nous n’avons pas d’argent à vous laisser, mais nous vous léguons les mérites que nous avons récoltés en aidant les personnes dans le besoin ». Mon grand-père maternel nous a également beaucoup marqués par ses actions. Lorsqu’il faisait froid, il nous demandait d’aller rendre visite aux sans-abris en leur apportant des nattes en paille et des vêtements chauds. Il nous invitait aussi, plusieurs fois par an, à préparer des repas pour les prisonniers. Dans ma famille, j’ai toujours vu ma mère et mon père, semblables à de solides chênes, s’occuper de nombreux neveux et nièces en plus de leurs neuf enfants. Ma mère accordait aussi de petits crédits à des personnes pauvres de son entourage pour qu’elles puissent lancer une micro activité et vivre de leurs gains.
Votre première rencontre avec Thich Nhat Hanh, en 1959, a-t-elle été déterminante ?
Je devais déjà être une nonne bouddhiste dans des vies antérieures. Quand j’ai lu mon premier livre sur la vie du Bouddha, j’ai tout de suite eu l’impression d’avoir trouvé ma voie.
Lorsque j’ai eu l’occasion d’écouter, pour la première fois, Thich Nhat Hanh s’exprimer, lors d’une conférence, j’ai été très impressionnée par ses propos. Ce qu’il disait me remuait au plus profond de moi-même. C’était le maître que j’attendais depuis longtemps. Son enseignement était si profond. Toute sa vie, il s’est employé à nous réveiller, il n’a cessé de nous appeler à ne pas vivre comme des automates.
« Les conceptions de Thich Nhat Hanh allaient bien au-delà des traditionnelles notions de charité consistant à fournir de la nourriture, des médicaments et de l’argent aux pauvres. Elles visaient à aider les paysans à améliorer eux-mêmes leurs conditions de vie sans avoir recours à une aide extérieure. »
Quand je l’ai rencontré, je partageais ma vie entre la faculté, où je suivais des études de biologie, et le travail social dans les bidonvilles. Je coordonnais une soixantaine de jeunes universitaires qui œuvraient bénévolement pour tenter d’améliorer la vie des sans-abris autour de Saïgon. Thich Nhat Hanh partageait les mêmes idéaux sociaux, mais il voulait aussi œuvrer pour la paix. Quand il a su que j’avais formé une équipe de soixante-dix personnes pour faire du travail social dans des bidonvilles autour de Saigon, il a aussitôt pensé que je pourrais l’aider dans sa mission sociale, à promouvoir une forme de bouddhisme engagé.
Thich Nhat Hanh insistait pour que le travail social que vous accomplissiez collectivement pendant la guerre du Vietnam ait une dimension spirituelle. Qu’est-ce qu’un engagement social sous-tendu par une dimension spirituelle ?
Dans l’École de la jeunesse pour le service social que nous avions créée, en 1965 au Vietnam, il y avait, au départ, trois cents jeunes volontaires qui s’impliquaient bénévolement au service des plus pauvres. Les conceptions de Thich Nhat Hanh allaient bien au-delà des traditionnelles notions de charité consistant à fournir de la nourriture, des médicaments et de l’argent aux pauvres. Elles visaient à aider les paysans à améliorer eux-mêmes leurs conditions de vie sans avoir recours à une aide extérieure. Il voulait faire passer l’idée que le travail social et le développement rural étaient des moyens de transformation personnelle et sociale. À la fin de la guerre, 10 000 travailleurs sociaux bénévoles œuvraient à nos côtés. Sans dimension spirituelle, les actions réalisées initialement avec la compassion et la vision profonde finissent par ressembler aux projets d’une entreprise commerciale. Si notre travail est dépourvu de toute dimension spirituelle, nous risquons d’oublier peu à peu les objectifs de nos actions au service d’autrui.
Dans votre livre La force de l’amour, vous évoquez une expédition humanitaire pendant la guerre du Vietnam, au milieu des combats et des tirs, et « une sorte de magnétisme et d’énergie de la bonté » qui vous aurait protégé des balles. Pouvez-vous préciser ?
Si vous êtes catholique, vous invoquez Dieu quand vous êtes dans la détresse. Les bouddhistes, eux, font appel à la bodhisattva Avalokiteshvara. En 1964, nous avons mis sur pied une expédition pour apporter des vivres, des vêtements et des fournitures médicales à des paysans dans une région en guerre, qui avait été dévastée par des inondations. Nous devions traverser des zones de combat pris en tenaille entre des belligérants des deux camps, communistes et anticommunistes. J’ai dit à mes amis qui étaient à mes côtés qu’il fallait invoquer Avalokiteshvara : « Avalokiteshvara, je vous laisse emprunter mon corps, mes bras et mes mains pour accomplir cette mission ». Quand vous lâchez prise et que vous le laissez agir à votre place, la peur vous quitte. Et le danger s’écarte de vous. Je me suis mise, assise dans une de nos cinq embarcations, à réciter le Sutra du Cœur, pendant que les balles sifflaient autour de nous. J’avais la conviction que les bombes, les grenades et les balles ne nous toucheraient pas, nous les combattants de l’amour, car nous serions protégés par Avalokiteshvara. Soudain, nous n’avons plus entendu un seul tir. La compassion l’avait emporté. Nous avons poursuivi notre mission, dans un silence religieux, en venant en aide aux blessés des deux camps.
Autre temps, autre crise. Quelles premières leçons pourriez-vous tirer de la pandémie du Covid-19, qui semble étroitement liée à la crise environnementale ?
Cette pandémie est la résultante d’une crise spirituelle. J’ai entendu Thich Nhat Hanh dire à propos des tremblements de terre et autres tsunamis de ces dernières décennies, comme celui survenu en 2004 dans l’Océan indien, que c’était une réaction de défense de la Terre mère, furieuse des dilapidations, pollutions et saccages commis à son égard. Nous avons une seule planète. N’oublions pas que, dans l’histoire, de grandes civilisations anciennes avancées se sont éteintes de façon subite. La crise du Coronavirus est un signal extrêmement important qui nous est envoyé : le signal qu’il faut arrêter de détruire la Terre. En même temps, au fur et à mesure de la progression de cette crise sanitaire, les discriminations se sont multipliées. Il faut apprendre à aimer comme nous l’a enseigné le Bouddha dans les quatre éléments du véritable amour : il faut apporter du bonheur et de la bonté aux autres (« maitri »), soulager la souffrance (« karuna »), cultiver la joie et un amour bienveillant et altruiste (« mudita »), et aussi l’égalité d’esprit que l’on nomme équanimité ou inclusivité. Cette période de confinement offre l’occasion aux femmes et aux hommes, trop investis en temps normal dans leur travail, de se retrouver et de se réconcilier avec leur corps et avec leur esprit. Elle nous offre l’opportunité de mettre un terme au flot des pensées qui, trop souvent, nous emporte, et de nous adonner à une gymnastique spirituelle et corporelle, en paix, le sourire aux lèvres. Libérés de ces pensées envahissantes, notre réflexion sera plus profonde et plus claire. C’est ce que l’on appelle le regard profond dans le bouddhisme zen. Au fur et à mesure que l’on se calme, la clarté d’esprit apparaît.
C’est le moment de consacrer davantage de temps à vos proches, à votre famille. Le moment de prendre le téléphone pour dire à ceux qui sont éloignés qu’on les aime et qu’on tient à eux.
Mais, avant de les appeler, il faut auparavant se défaire des rancœurs ou de la peur, qui, trop souvent, nous font commettre des erreurs que l’on regrette par la suite. Quand on est en colère ou si l’on a peur, il faut s’efforcer de ne pas parler ni d’agir dans l’instant, se concentrer sur son souffle et se calmer en portant son attention sur sa respiration, sur l’inspiration et l’expiration. Le souffle ramène l’esprit vers le corps. Je calme mon cœur, mes poumons, mon visage, mon cerveau, mes bras, mes jambes, tout mon corps. Je suis une spécialiste de la relaxation totale et des touchers de la terre, qui permettent de se défaire des limitations héritées de nos ancêtres, et de lâcher prise avec l’idée que je suis ce corps, et que ma durée de vie est limitée. Nous sommes tous Un. La planète a besoin, aujourd’hui, d’entendre ce message d’unité, en cette période de crise du Coronavirus.