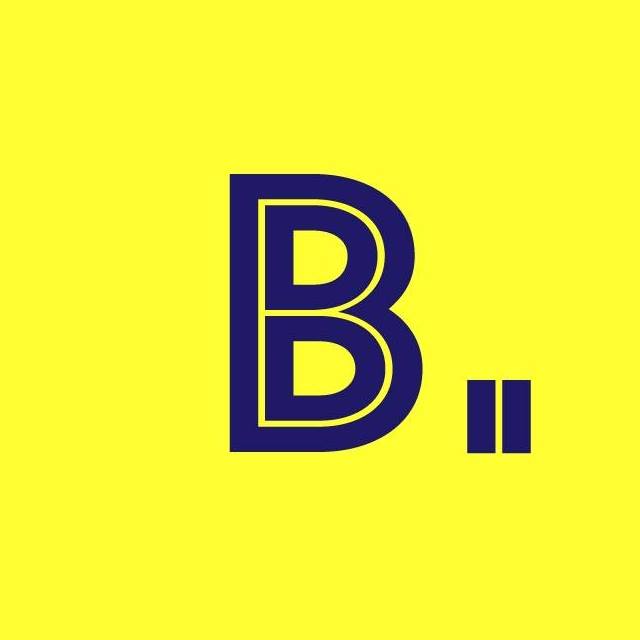Quand avez-vous commencé à pratiquer le zen ?
Je me suis initié à la pratique du zen à San Francisco aux États-Unis à la fin des années 70, où je m’étais établi comme chauffeur de taxi après avoir traversé le pays d’est en ouest en auto-stop. En 1980, je me suis engagé aux côtés des Indiens d’Amérique, participant à la « longue marche pour la survie » de San Francisco jusqu’aux Nations-Unies à New York. Cette marche était une prière pour mettre fin à l’exploitation des mines d’uranium dans les réserves indiennes, une prière aussi pour les femmes indiennes, stérilisées au cours des années 60 et 70 par l’Indian Health Service. Tel fut mon premier acte militant.
Après cette cause, quel a été le déclic de votre implication auprès des plus démunis ?
J’ai eu le bonheur de faire la connaissance de Bernie Glassman au Los Angeles Zen Center, au début des années 80. Cet enseignant du zen, qui fut le premier successeur de Taizan Maezumi Roshi, l’un des pionniers du bouddhisme en Occident, était déjà très investi dans l’action sociale à New York. Il m’avait alors interpellé en nous disant : « La pratique, c’est de devenir de plus en plus vulnérable et sans abri ». Il allait devenir mon second maître. Quinze ans plus tard, alors que j’étais rentré depuis quelque temps en France, Bernie Glassman nous a proposé – à Catherine Pagès, ma compagne, et à moi-même – une retraite de rue en Allemagne, à Cologne et à Düsseldorf. Cette épreuve de méditer, de marcher, de dormir, de mendier et de manger dans la rue, quatre jours durant, a bouleversé radicalement notre perspective. « Il faut se sentir plus proche de ceux que l’on aide », nous encourageait Bernie. C’est une expérience assez éprouvante que je pratique encore, car elle permet de lâcher son conditionnement et de s’ouvrir à l’inconnu. On ne devient pas SDF, on est tout simplement auprès d’eux. On ne se sent pas « autre », mais vulnérable. Cela comble une partie du fossé en effaçant la peur de cet autre qui n’a pas de toit, et cela nous renvoie à notre propre précarité. Dans la foulée, j’ai pris l’engagement de servir des repas à des déshérités. En 2004, j’ai cofondé l’association L’un est l’autre. On a commencé par distribuer 80 repas le dimanche, sur le trottoir de la rue de Flandre, à Paris. L’an passé, nous en avons servi plus de 120 000, trois fois par semaine. L’un est l’autre est une association laïque, magnifique, qui rassemble près de 200 bénévoles d’une grande diversité ainsi que des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général.
Comment conciliez-vous méditation et action de terrain ?
Je me souviens de l’une des retraites conduites par mon maître Genpo Roshi en 1985. Il a demandé à plusieurs d’entre nous de donner un enseignement. Quand mon tour est arrivé, Genpo Roshi a vu que j’avais des notes et s’en est emparées. « Si tu parles avec tes notes, m’a-t-il dit, tu le feras avec ta tête ». Et il a ajouté : « Trust your heart » – « Fais confiance à ton cœur. J’ai confiance en ton cœur. » Cela fut pour moi un profond kôan ! J’ai de plus en plus confiance en l’intime – en deçà et au-delà de mes pensées –, en l’intime inconditionné.
« J’ai connu ma part d’erreurs de jeunesse et je me suis pas mal bagarré. Cela me permet de regarder les personnes détenues sans le moindre jugement. »
À son tour, Bernie Glassman m’a invité à dissoudre cette étanchéité. Jusque-là, je compartimentais ma vie. Avec le cœur, elle s’est peu à peu désenclavée. Elle est devenue de plus en plus une seule et même chose. Que je commence chacune de mes journées par une séance de méditation à Dana ou que je sois auprès des plus démunis, je lâche mes idées, je m’ouvre à l’inconnu et je laisse cette expérience de non-différenciation, de non-dualité, m’imprégner. Dans le Metta Sutta, le sutra de l’Amour bienveillant, un texte pali fondamental, le Bouddha nous exhorte à aimer chaque être vivant « comme une mère aime son unique enfant ». C’est une invitation à prendre soin de l’autre avec une générosité totale. De la même façon, dans une longue version du sutra de la Grande Sagesse Parfaite (Prajna paramita sutra), lorsque le fidèle Subuti demande à Bouddha : « Comment un bodhisattva fait-il une offrande pour secourir les êtres vivants ? », celui-ci lui répond : « Il nourrit ceux qui ont faim, il offre aux êtres humains tout ce qui peut leur être utile ». Je suis frappé par la similitude avec un passage de l’Évangile de Saint-Matthieu : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger ; j’étais en prison et vous m’avez visité. Je vous le dis, tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Puisque vous évoquez la prison, de quelle façon vous occupez-vous des prisonniers à Fresnes, où vous êtes aumônier ?
J’ai été nommé parmi les premiers aumôniers bouddhistes en 2012, par l’entremise de mon ami Éric Rommeluère, un enseignant du zen, qui a présidé à la naissance de l’aumônerie bouddhiste de prison. La prison, lieu de grande souffrance et d’insécurité, me ramène aux fondations de la voie du bouddhisme – le mal-être, la cause de la souffrance, la fin de la souffrance et le chemin qui mène à sa fin. En tant qu’aumônier, on ne peut vraiment circuler entre ces murs qu’avec bienveillance. Il y a très peu de bouddhistes parmi les prisonniers ; ceux qui demandent à me voir et qui participent à mes groupes de méditation sont de toutes confessions. Je ne fais pas de prosélytisme, j’encourage les détenus à pratiquer leur propre religion. J’enseigne que nous sommes tous là, à Fresnes, à cause de l’enchaînement des causes et des effets, autrement dit que nous sommes les héritiers de nos actes et de nos intentions. À partir du moment où l’on change sa perspective, où l’on agit avec bienveillance envers soi-même et envers les autres, notre vie se transforme. On dit que la prison est un lieu de radicalisation. J’observe qu’elle est aussi un lieu de grande tolérance et de fraternité entre toutes les confessions. Un jour, un détenu musulman m’a dit : « Toi, tu es un vrai musulman ! », citant à l’appui un hadith qui énonce : « Celui qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur ». Il a ajouté : « Toi, tu nous donnes une méthode pour nous connaître ». Cela m’a touché.
Que ressentez-vous quand vous côtoyez la souffrance ?
Mon action auprès de ceux qui sont tombés dans les failles de la société m’invite à travailler sur mes zones d’ombre, sur les parts rejetées de moi-même. J’ai été mis en pension à un âge où j’étais trop jeune et, à 22 ans, j’ai commencé à bourlinguer en routard au Maghreb, à travers l’Afrique et dans les îles de l’Océan Indien. J’ai connu ma part d’erreurs de jeunesse et je me suis pas mal bagarré. Cela me permet de regarder les personnes détenues sans le moindre jugement. Quant à l’expérience des retraites de rue, elle me met à nu ; elle me ramène à ma vulnérabilité, à ma propre impermanence. C’est quelque chose d’important qui contribue à m’attendrir et à m’ouvrir le cœur »