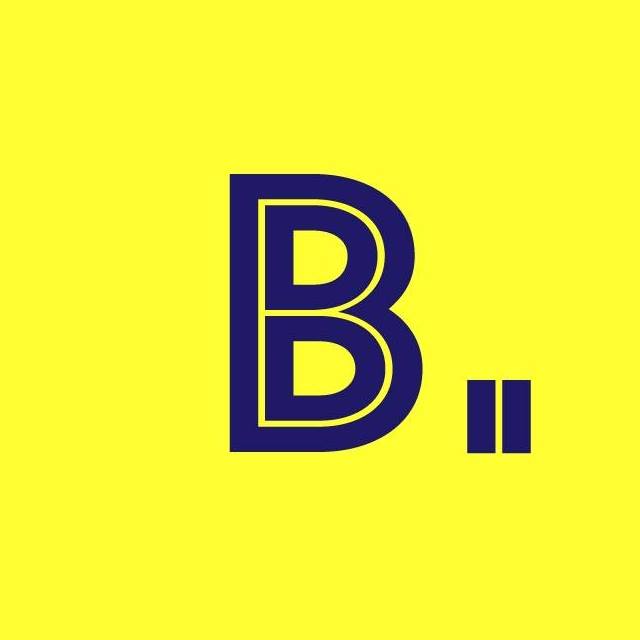Vous souvenez-vous de votre tout premier contact avec le bouddhisme ?
Ce n’est pas très clair, je crois que j’ai commencé par lire les livres de Lobsang Rampa. Je connaissais certainement Matthieu Ricard et Arnaud Desjardins qui venaient à la maison dans les années 68, mais je ne me souviens plus très bien, j’avais quinze ou seize ans à l’époque. Enfant, j’ai commencé à m’intéresser à la spiritualité, notamment au Raja Yoga, mais le yoga ne me suffisait pas. Et, quand j’ai entendu parler de l’interdépendance des phénomènes du bouddhisme, des Tibétains et des lamas tibétains, je me suis dit : « Ça, c’est pour moi, j’y vais ! ».
Vous partez donc en Inde…
Oui, je lâche tout et je me rends en Inde. Je venais de perdre ma grand-mère. En la voyant mourir, j’ai pensé : « Si la vie ne s’arrête pas là, pour vivre tranquillement, la première chose à faire est d’apprendre à mourir. Et savoir ce qui se passe derrière le rideau ». Quel « cadeau » elle m’a fait, d’une certaine manière, cela m’a poussé à vouloir résoudre cette question existentielle. Comme il n’y avait personne en Occident pour m’aider – le catholicisme m’avait déjà rebutée à l’âge de cinq ans -, je me suis dit qu’un maître tibétain devait savoir ces choses-là. Mon père était l’un des inventeurs des ordinateurs et du stockage des données informatiques dans les années 1950-60 et un chercheur spirituel infatigable. Un jour, alors qu’il revenait d’un voyage en Inde, il a déclaré : « J’ai rencontré l’être le plus merveilleux de toute ma vie. Il s’appelle Kangyur Rinpoché », et j’ai fondu en larmes ! Quelque chose s’était ouvert dans mon esprit.
« Cela m’attriste de constater, notamment chez les gens riches et les puissants, que l’intelligence est de plus en plus souvent mise au service de l’avarice que de la compassion et du bien-être général. »
Un mois plus tard, je m’installe à Paris pour suivre mes études. Le problème existentialiste que m’avait posé le décès de ma grand-mère continuait à me tarauder. C’était après Mai 68, les professeurs rasaient les murs et avaient peur des élèves ; je ne voyais pas comment ce genre d’enseignants allaient pouvoir m’apprendre à mourir et à vivre. Une réponse me traversa l’esprit : Kangyur Rinpoché, lui, saura ! Consciente que ce départ serait une sorte d’adieu à la vie de jeune fille de famille aisée que je menais, je me suis donné un mois de réflexion. Puis j’ai annoncé à mon père que je voulais partir en Inde. Il m’a offert le billet. Arrivée dans un coin perdu de Darjeeling, dans la minuscule pièce en ciment où vivaient Kangyur Rinpoché et sa femme, Amala, je me sentis comme E.T (l’extraterrestre du film de Steven Spielberg) rentrant à la maison ! J’avais trouvé ma famille, et ce que je cherchais plus ou moins consciemment depuis toujours. C’est ainsi que je suis restée au monastère de Kangyur Rinpoché, dans sa famille, pendant près de cinq ans.
Avez-vous tout de suite commencé à pratiquer régulièrement ?
Je devais d’abord comprendre ce que disait Rinpoché. Il ne parlait que le tibétain et il n’y avait pas d’interprète. Mais quand Yangchenla, sa deuxième fille était là, malgré son anglais très approximatif, nous pouvions communiquer, ce qui m’a sauvée. Je savais qu’au-delà des mots, Rinpoché connaissait tout ce que je ressentais et que je pouvais lui ouvrir mon esprit. Mais concernant les pratiques qu’il me conseillait, c’était plus compliqué… À un moment donné, j’ai vaguement compris que je devais faire les pratiques préliminaires (1). C’est-à-dire ? Personne ne me les avait expliquées. Rinpoché m’a alors dit : « Cela te prendra environ un an ». Peu m’importait, j’étais prête à tout, mais je voulais commencer par le début. Je ne savais pas m’asseoir et méditer devant Rinpoché, comme le faisaient Matthieu Yahne le Toumelin et les autres « grands ». Dès que je m’asseyais devant lui, mon esprit partait dans toutes les directions ! Alors, j’ai voulu commencer par A, B, C, en apprenant le tibétain pour déchiffrer ces fameuses « pratiques préliminaires », car je sentais profondément que si je pouvais devenir ne serait-ce qu’un peu comme lui, ma vie aurait du sens.
Aujourd’hui, approchez-vous de la lettre Z ?
Je dois en être à B ou à C, je pense ! La pratique bouddhiste est très vaste ; chaque porte qu’on entrebâille laisse apparaître tout un monde. Mais puisque Rinpoché et d’autres l’ont fait, cela signifie que c’est faisable, même si cela prend plusieurs vies. Tant que je suis la voie et que je vais dans la bonne direction, ça me va.
Comment vivez-vous le bouddhisme au quotidien ?
Cela fait quarante-huit ans que l’inspiration et la présence de Kangyur Rinpoché, ainsi que la pratique bouddhiste, imprègnent ma vie. De plus, la voie bouddhiste est passionnante. Il y a tant de choses à découvrir, à comprendre. Ces techniques éprouvées permettent d’aller au fond de soi-même, de son esprit. Quand on les pratique et les applique correctement, on commence à trouver des réponses, on voit que ça marche. Les maîtres tibétains étudient la sagesse, l’esprit humain et ses liens avec l’environnement depuis 1800 ans ; c’est leur violon d’Ingres et, connaissant leur ténacité et leur diligence légendaire, leur expertise est insondable. La sagesse, l’Éveil et le bonheur des êtres sont les seules choses qui les intéressent ; ils y appliquent tout leur cœur et leur intelligence, laquelle n’a rien à envier à celle des plus grands ingénieurs ou scientifiques d’ici…
Pouvez-vous nous parler de la maison d’édition Padmakara ?
Elle fut créée en 1980 par Pema Wangyal Rinpoché, le fils aîné de Kangyur Rinpoché. Arrivé en France en 1975 avec Dilgo Khyentsé Rinpoché, Pema Wangyal Rinpoché nous avait dit : « On ne peut pas demander à tout le monde d’apprendre le tibétain, il faut traduire les pratiques et les enseignements ». Mais encore fallait-il comprendre ce dont ils parlaient. Pour parvenir à saisir leur sens profond, les premiers traducteurs ont fait de trois à douze ans de retraite. Le premier livre, Le chemin de la grande perfection, nous a pris dix ans de travail ! Et, depuis, il reste le best-seller des éditions Padmakara.
Quel regard « bouddhiste » portez-vous sur le monde moderne ?
Si je suis venue dans ce monde, autant l’aimer, le prendre à bras le corps. Quand on fait des années de retraite, contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est pour mieux embrasser le monde ensuite. J’ai envie de contribuer à faire en sorte que les choses aillent dans la bonne direction. Les membres de la communauté bouddhiste sont depuis longtemps des lanceurs d’alerte : dans les années 50, mon père prévenait déjà du danger à long terme des déchets nucléaires (il faut 4,5 milliards d’années pour effacer toute trace de l’uranium 238, ce que les lobbyistes du nucléaire évitent soigneusement de nous dire) ; Pema Wangyal Rinpoché nous supplie depuis plus de trente ans de manger moins de viande, d’arrêter de vider les océans, de respecter les animaux, de devenir végétarien, voire vegan. Avant l’occupation chinoise, les Tibétains étaient très respectueux de la Terre ; ils ne la volaient pas en exploitant ses richesses et prenaient le minimum nécessaire pour vivre. Ils ne creusaient pas la terre pour trouver du charbon, du pétrole ou des minéraux précieux. Et, quand on trouvait de l’or, par exemple dans les rivières, on estimait que la Terre l’avait donné et l’on s’en servait en général pour faire des offrandes ou dorer des statues du Bouddha. Pour les bouddhistes, une image du Bouddha représente la véritable nature de l’esprit, l’Éveil, le but de la voie, la fin de la souffrance. Faire dorer une statue du Bouddha est un geste « gratuit » inspiré par la compassion, qui nous aide à nous libérer notamment de l’attachement aux biens matériels. Aujourd’hui, ce genre de démarche, comme la construction des stoupas pour la paix ou la libération des animaux dans leur milieu naturel, n’est souvent pas compris du grand public. Cela m’attriste de constater, notamment chez les gens riches et les puissants, que l’intelligence est de plus en plus souvent mise au service de l’avarice que de la compassion et du bien-être général. Depuis quand érige-t-on les vices en qualités ? Le monde est devenu fou