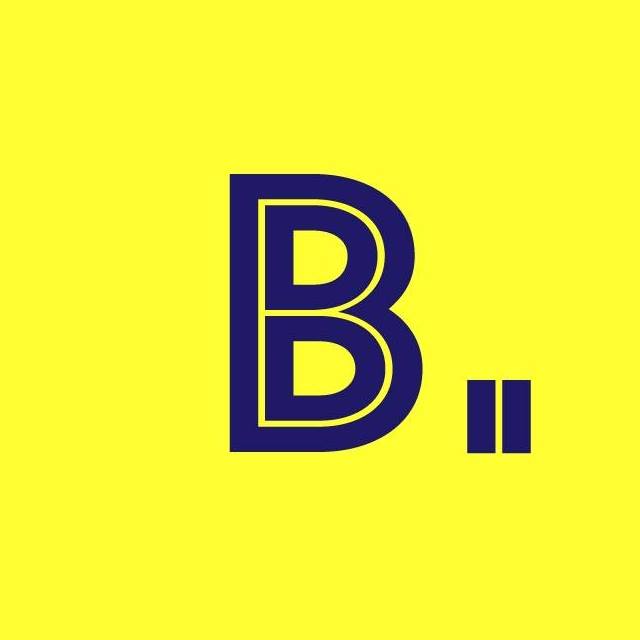Originaires du Kham, dans le sud-est du Tibet, vos parents ont fui leur pays à la fin des années 1960. Pour quelles raisons ?
Dès les années 1950, mon père, membre de la résistance tibétaine, faisait passer des armes depuis l’Inde pour combattre les Chinois. En 1959, malgré dix ans de négociations entre le gouvernement tibétain et la Chine, aucune solution n’ayant été trouvée, le 10 mars, des milliers de Tibétains convergèrent vers Lhassa pour protester contre l’occupation et protéger le Dalaï-Lama. Ce soulèvement, réprimé dans le sang, conduisit le Dalaï-Lama à quitter le pays. De nombreux Tibétains le suivirent, dont mes parents qui traversèrent l’Himalaya, à pied, jusqu’à la province indienne du Sikkim, où ils restèrent quelques années. En 1974, le gouvernement indien offrit des terres aux Tibétains dans le sud de l’Inde. Je suis né dans un camp de réfugiés, dans le Karnataka, en 1974 ou 1975 – l’année du Tigre de bois selon le calendrier tibétain.
Comment votre parcours vous a-t-il mené en France ?
Après avoir terminé mes études, financées par le gouvernement tibétain en exil, je me sentais redevable. J’ai donc rejoint Dharamsala en 1999, où j’ai travaillé quelques mois en tant que bénévole, avant de réussir le concours me permettant d’intégrer le gouvernement. J’ai travaillé six mois au Département intérieur, qui gère la situation des réfugiés en Inde. Puis je suis passé au Département de l’information et des relations internationales, pendant six ans. Celui-ci publie des journaux et des livres sur la situation des Tibétains en exil. Toujours à Dharamsala, j’ai rencontré une Française, avec qui j’ai un enfant aujourd’hui. Je suis venu avec elle en France, en 2006. Traducteur et interprète, je me suis rapidement investi dans l’association Étudiants pour un Tibet libre, qui cherche à sensibiliser sur la situation du Tibet et à créer du lien avec la troisième génération tibétaine qui grandit ici.
Votre association commémore, chaque année, le 10 mars 1959. Que représente cette date pour les Tibétains ?
C’est l’une des dates anniversaires les plus importantes pour les Tibétains en exil. À Paris, nous organisons au moins une manifestation ce jour-là, avec des personnes de tous âges, toutes professions. Il s’agit d’un devoir de mémoire. Les Tibétains disent souvent que « les arbres ont des racines et les hommes ont l’histoire ». S’il n’a pas confiance en son histoire, le peuple tibétain séchera comme un arbre sans racine.
Reconnaissez-vous le gouvernement tibétain en exil comme votre représentant légitime ?
Il s’agit de notre représentant et, de surcroît, de la continuation du gouvernement installé au Tibet avant l’occupation chinoise. Mais, alors que le gouvernement réclame aujourd’hui l’autonomie pour le Tibet, notre association demande l’indépendance. Ce qui se passe aujourd’hui à Hong Kong ou chez les Ouïghours – avec plus d’un million de personnes enfermées dans les camps – ne me donne pas confiance dans le Parti communiste chinois. Pour ce dernier, la culture, la langue, la religion et la philosophie tibétaines représentent un défi à leur domination. Nous rejoignons cependant la position du gouvernement sur les moyens pour parvenir à notre objectif, à savoir la voie non-violente.
« Le Dalaï-Lama restera toujours un leader spirituel pour les Tibétains. Il est le socle qui nous réunit, qui nous donne l’espoir. »
Votre volonté d’indépendance concerne-t-elle les provinces historiques du Tibet ou cela va-t-elle au-delà ?
Pour nous, comme pour le gouvernement tibétain en exil, les revendications concernent les trois régions historiques, à savoir le Tibet central (Ü-Tsang), qui correspond à la région autonome actuelle, l’Amdo et le Kham. Le parlement tibétain en exil regroupe 43 députés élus : dix députés pour le Tibet central, dix pour le Kham, dix pour l’Amdo, deux représentants pour chacune des quatre écoles du bouddhisme Vajrayana et deux pour la tradition Bön. À ceux-là, il faut rajouter deux représentants pour les Tibétains en Europe et un pour l’Amérique du Nord. On entend parfois parler de prétendues revendications pour un grand Tibet, qui déborderait sur d’autres provinces chinoises et indiennes. Mais cette cartographie n’est pas la réalité, elle a été créée autrefois par les colons britanniques et est reprise aujourd’hui par le gouvernement chinois pour nous disqualifier.
Reconnaissez-vous le Dalaï-Lama comme un chef spirituel, un leader politique ?
Je suis né en Inde, au sein de ce que j’appelle « la génération du Dalaï-Lama ». Il était le seul leader que j’avais connu jusqu’en 2011, date à laquelle la constitution a été changée, à sa demande. Le Dalaï-Lama ayant alors renoncé à tout rôle politique, j’utilise désormais mes droits d’élire mon propre dirigeant (le gouvernement actuel est dirigé par le Premier ministre Lobsang Sangay depuis 2011, ndlr). Mais le Dalaï-Lama restera toujours un leader spirituel pour les Tibétains. Il est le socle qui nous réunit, qui nous donne l’espoir. Et cela va bien au-delà de la personne du XIVe Dalaï-Lama, Tenzin Gyatso. Cela tient à l’institution et remonte au moins jusqu’au Ve Dalaï-Lama (1617-1682).
Aujourd’hui, face à la montée en puissance de la Chine, nombre d’associations tibétaines ont mis de côté la lutte politique pour se recentrer sur les questions d’environnement, de droits de l’homme et de la femme, de défense de la culture. Qu’en pensez-vous ?
Un combat n’exclut pas l’autre. La culture, la langue et l’environnement sont des questions cruciales. Sans cela, nous serons balayés. Mais notre association souhaite être claire sur l’objectif final de notre lutte, à savoir l’indépendance. Aujourd’hui, on a l’image, véhiculée par la propagande, d’une Chine très puissante. Mais je pense qu’elle est plus fragile qu’on ne le pense. Tout est contrôlé par Xi Jinping. Le jour où il aura un problème de santé, les divisions risquent d’éclater au grand jour. Plusieurs reportages ont montré comment les quelques milliers de Tibétains et les quelques centaines d’Ouïghours en France sont surveillés. Pour moi, ça montre que la Chine a peur.
Comment vous êtes-vous adapté à la vie en France ?
Je ne parlais pas la langue, je ne connaissais pas la culture, mais ma compagne française m’a aidé. Pour la plupart des Tibétains, c’est plus compliqué… Ne sachant pas lire l’alphabet latin, ils ne peuvent pas déchiffrer les adresses. Pour se déplacer en métro, ils se repèrent grâce aux couleurs des lignes et au nombre de stations… Quand je suis arrivé, il y avait 300 Tibétains en région parisienne. Souvent, les week-ends, on se retrouvait au parc Montsouris pour des cours de danse et des chants traditionnels. À la pagode du bois de Vincennes et au centre bouddhiste de Levallois, on organisait des sessions de prières. Les visites du Dalaï-Lama en 2008, 2011 puis 2016 nous ont aussi aidés à ne pas nous sentir trop éloignés. Enfin, les Français sont solidaires de notre cause. Et je remarque que, finalement, les Français et les Tibétains ne sont pas différents : on aime manger de la viande et du fromage, tout comme boire du vin !
Pratiquez-vous toujours le bouddhisme Vajrayana ?
Chez moi, j’ai un petit autel avec un tanka et une photo du Dalaï-Lama. Le matin, je prends un peu de temps pour brûler de l’encens et réciter quelques prières. Si mes parents sont issus de la tradition Gelugpa, ma pratique est toutefois plus ouverte. J’essaye de faire ce que préconise le Dalaï-Lama : devenir un bouddhiste du XXIe siècle engagé. Il s’agit de conserver le bouddhisme Vajrayana dans les rituels et d’essayer de comprendre les commentaires des grands maîtres. Car, parfois, nous avons tendance à être dans les rites sans vraiment saisir la philosophie. Tout doit être fait pour garder la richesse de notre culture.