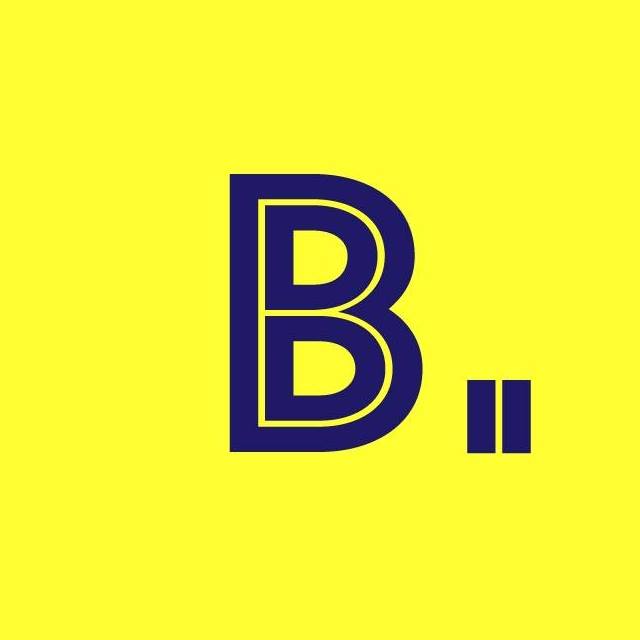Quelle est votre ambition pour le refuge que vous créez au Plessis ?
Elle est un peu démesurée ! Créer une oasis de bonté et de beauté dans un monde qui s’effondre ? Plus sérieusement, je suis convaincu que le centre bouddhiste à l’ancienne – je le dis sans aucun mépris – n’est plus adapté. Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus tant de s’initier ou de méditer que d’agir, même à une petite échelle. Depuis quinze ans, je rêve de bâtir un espace qui soit à la fois un refuge et une plateforme pour un bouddhisme engagé. Lorsque j’ai découvert cette demeure du Plessis, à 1h30 en train de Paris, j’ai décidé de me lancer dans cette aventure un peu folle. Toutes mes économies y sont passées, alors que les travaux à prévoir sont considérables ; il n’y a pas d’eau courante ou de toilettes par exemple. Mais c’est 350 m2 habitables, 700 à terme, au milieu de trois hectares de terrain et de forêt. Et comme c’est en zone naturelle protégée, la mairie nous oblige à prendre soin de cette nature – elle nous oblige à être bouddhistes en fait ! C’est beau, c’est calme, tout simplement merveilleux. Dans l’immédiat, je fais appel aux bonnes volontés et à un financement participatif pour réaliser des travaux de première nécessité. Si nous voulons en faire un véritable temple bouddhiste un jour, il faudra notamment être en conformité avec les normes pour établissements accueillant du public. Tout restera gratuit, bien sûr, et chacun peut d’ores et déjà me rejoindre dans cette aventure à titre privé.
En quoi votre démarche s’inscrit-elle dans la continuité des érudits zen Bernie Glassman et David Loy ?
Le refuge du Plessis sera bâti comme un « écodharma lieu ». Ce concept, que j’emprunte à David Loy, est né d’une réflexion encore ouverte sur les implications écologiques du bouddhisme – notamment l’idée qu’il n’y a pas de séparation radicale entre l’humanité et la nature, et que le sort de l’une vaut aussi pour l’autre.
« Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus tant de s’initier ou de méditer que d’agir, même à une petite échelle. Depuis quinze ans, je rêve de bâtir un « écodharma lieu », un espace qui soit à la fois un refuge et une plateforme pour un bouddhisme engagé. »
Très concrètement, nous allons tout faire pour nous passer de béton et de plastique, recycler l’ensemble de nos déchets ou encore mettre en place l’autonomie énergétique et alimentaire. Je ne sais pas si nous y arriverons totalement, mais c’est aussi cela le bouddhisme engagé : on agit, on essaye, on fait autant que possible et pour le mieux… Bernie Glassman est aujourd’hui l’un des érudits zen les plus emblématiques de cette approche. Il demandait par exemple à ses disciples de vivre sept jours sans argent dans les rues de New York, pour mieux prendre conscience de la misère. En parallèle, il créait une boulangerie dédiée aux personnes SDF. Je l’ai suivi à deux retraites dans les camps d’Auschwitz, sans savoir à quoi m’attendre, et sur place, j’ai compris qu’il était important d’actualiser l’enseignement que nous avions reçu. Non pas le remettre en doute, mais éprouver ce que pouvait être la souffrance dans ses formes les plus contemporaines pour adapter notre pratique en conséquence. David Loy s’inscrit dans la même veine et m’a aidé à concevoir une déclinaison du bouddhisme engagé pour la France.
Cela vous a notamment inspiré le « programme BASE » – très américaine comme appellation d’ailleurs ! Quelles en sont les grandes lignes ?
C’est un acronyme pour « Bouddhisme Action Sociale et Engagement ». Nous avons pris cinq ans pour le développer avant son lancement en 2013. Notre constat de départ est double : beaucoup de personnes perdent le goût d’agir dans un monde en crise, ils ont le sentiment qu’on ne peut rien faire. Et, d’autre part, de plus en plus de bouddhistes laïcs, plus ou moins érudits, cherchent des manières de faire vivre le dharma, la spiritualité, sans parvenir à les trouver seuls. Le programme BASE consiste tout simplement à constituer des petits collectifs de pratiquants sur une durée limitée – six à douze personnes pendant six mois le plus souvent. Il y a bien sûr une part de dialogue, d’échanges et même de rituels, toujours dans la perspective d’une actualisation des enseignements que chacun a reçus. Mais aussi une série d’engagements : prendre soin des autres, donner de son temps à une association caritative par exemple, apprendre à écouter et à se confier, et surtout à travailler en communauté pour améliorer les choses. Chaque collectif reste assez libre de son fonctionnement, l’organisation est totalement décentralisée. Nous insistons juste sur la nécessité de structurer les réunions et les actions menées. L’enjeu est que chacun en ressorte avec le sentiment d’avoir changé les choses et d’être soi-même un peu transformé par cette expérience.
Pour ce qui vous concerne, la justice est un thème qui vous a particulièrement tenu à cœur…
Plus je me suis documenté sur l’état du monde, plus je me suis politisé. La justice fait partie de ces thèmes canoniques qui permettent de mettre en perspective tous les autres. Mais, plus concrètement, l’Union Bouddhiste de France m’a demandé de travailler à la création d’aumôneries en milieu carcéral, au début des années 2010. Cette expérience formidable m’a plongé au cœur des questions et des difficultés que soulèvent les prisons. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un système qui se contente de mettre à l’écart ou d’exclure, beaucoup de fonctionnaires travaillant dans ce domaine sont d’ailleurs les premiers à plaider en ce sens – gardiens de prison comme magistrats. Cela m’a amené à travailler avec la Fédération Protestante de France et à découvrir, grâce à eux, le concept de « justice restaurative » développé par l’universitaire américain Howard Zehr. L’idée est de sortir d’une logique punitive. Pour un bouddhiste comme moi, infliger une souffrance en proportion d’un méfait ou d’un crime ne peut être que contre-productif. L’enjeu est donc de définir ce que serait un nouveau paradigme : une justice qui puisse sanctionner sans violenter, et qui, surtout, donne à chacun la possibilité de repartir du bon pied plutôt que de se retrouver enferré dans un statut d’exclu. J’y travaille au sein de collectifs.
Vous valorisez l’innovation et l’engagement en vertu d’une vision « non occidentale » du bouddhisme : que voulez-vous dire exactement ?
En France, mon côté multicarte étonne beaucoup de pratiquants bouddhistes, quand je dis que partager des recettes de cuisine vegan et militer pour une transition alimentaire est aussi une façon de vivre ma spiritualité par exemple. Je mets cet étonnement sur le compte d’une tradition rationaliste prédominante en Occident. Nous sommes les enfants de Platon et d’Aristote, des chercheurs de vérité qui traçaient une démarcation nette entre le réel et l’illusoire. C’est dans cet esprit qu’on imagine le bouddhisme comme devant recouvrir un dogme absolu et intangible. Et pourtant la notion de « vérité » n’existe pas vraiment dans ce cadre, il y est plutôt question d’efficience : mes croyances et mes valeurs m’offrent-elles la possibilité de me transformer et d’améliorer les choses, indépendamment du fait qu’elles soient vraies ou fausses ? Le bouddhisme procède fondamentalement par « acte de langage » : si je dis ou pense quelque chose et que j’obtiens l’effet escompté, alors cela s’en trouve justifié – un peu comme quand on fait une promesse sans savoir si on pourra la tenir et qu’on y parvient. C’est d’ailleurs pourquoi je m’intéresse autant aux initiatives américaines : bien que ce soit un pays occidental, on retrouve de fortes parentés avec le bouddhisme dans la philosophie pragmatique qui y est si populaire – celle défendue par William James, Emerson ou encore Thoreau. C’est l’idée que ce que l’on voit ou perçoit est comme un mouvement tendu entre le réel et l’imaginaire. Être bouddhiste revient fondamentalement à épouser cet élan, et non à tenter de le fixer