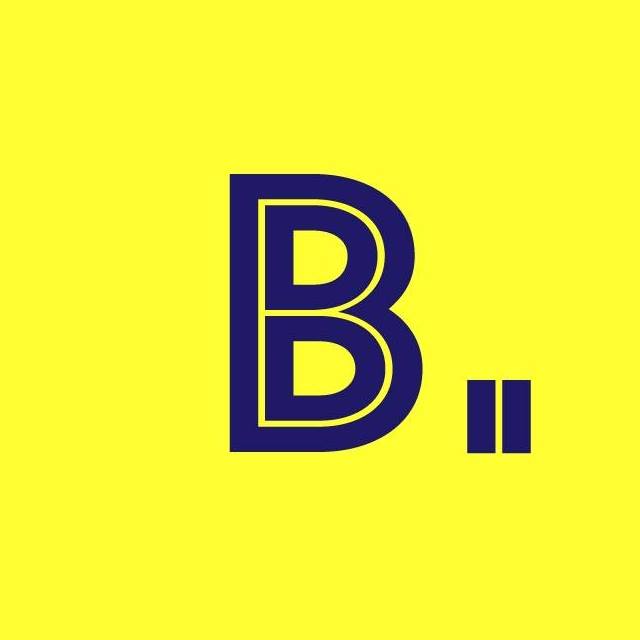Au sujet de la pandémie, vous avez dit refuser de parler de « crise » : comment alors qualifieriez-vous ce que l’on est en train de vivre ?
Le terme de « crise » vient du monde médical à la base, avec l’idée de revenir ensuite à un état antérieur. Je pense qu’on vit plutôt une catastrophe, dans le sens où elle va induire un changement – en grec ancien, la « katastrophê », c’est le renversement, le tournant. La catastrophe suppose de reprendre son développement dans une tout autre direction.
Et on peut effectivement penser que pas mal de choses vont changer, comme notre organisation économique, par exemple : va-t-on mieux partager le travail, revaloriser les métiers utiles, etc. ? Il me semble aussi certain que nos pratiques culturelles vont évoluer, en accordant peut-être plus de place au lien social. Il faut aussi espérer que cela nous permette enfin de changer notre rapport au reste du vivant… Dans l’histoire de la vie sur la Terre, il y a déjà eu cinq extinctions où toute la faune et la flore disparaissaient complètement. Et je crois qu’on est en train de préparer la 6e extinction.
C’est cela qui est profondément en cause, dans cette catastrophe : la place de l’humain dans son environnement ?
S’il y a une telle pandémie, c’est parce qu’on a oublié qu’on fait partie du monde vivant, qu’on partageait la planète avec les animaux. On a cru qu’on était une espèce à part, au-dessus de la condition naturelle, soit à cause de la religion, soit à cause de l’artifice de la technique et de la parole. Alors qu’on est régi par les mêmes principes que tous les animaux sexués, nous sommes engendrés de la même façon que les mammifères, nous avons les mêmes besoins alimentaires, etc. On est en train de redécouvrir que si l’on néglige et abîme les animaux, par des élevages intensifs ou en détruisant leur écosystème, on crée toutes les conditions pour développer des virus qui peuvent nous faire disparaître… En somme, si on massacre le monde vivant, on part avec lui.
Mais on a cru pendant 70 ans que les épidémies appartenaient au passé. On réalise en fait que l’hyper-technologie ne nous en protège pas, au contraire, elle crée même les conditions de sa propagation accélérée : avec l’aviation et les transports rapides, c’est nous qui avons déplacé le virus aussi rapidement ! Et si on ne change pas cela, d’autres épidémies arriveront.
Vous avez beaucoup pratiqué l’éthologie : est-ce une discipline qui pourrait nous aider à mieux appréhender nos relations avec le reste du monde vivant ?
Je regrette que l’on n’ait pas plus développé l’éthologie. Les stéréotypes culturels restent très forts, les décideurs – ceux qui financent les laboratoires et créent des postes de recherche – pensent encore que les animaux ne sont pas une priorité : dans ma carrière, je me suis souvent entendu dire qu’il était inutile d’étudier la sexualité chez les babouins, qu’on n’allait pas donner de l’argent pour interroger le transport des virus par les chauves-souris…
« S’il y a une telle pandémie, c’est parce qu’on a oublié qu’on fait partie du monde vivant, qu’on partageait la planète avec les animaux. »
Pourtant, on le sait depuis longtemps : toutes les épidémies de virus, les pestes bacillaires, la tuberculose, le choléra, la syphilis, etc., toutes ces maladies-là sont parties des animaux et c’est notre monde humain qui les a ensuite distribuées sur la planète entière. C’est un processus qui se répète régulièrement ! La seule différence, c’est qu’avant, quand une épidémie se propageait, l’explication était magique : cela venait d’un mauvais œil, de Dieu qui nous punissait parce qu’on avait commis un péché, etc. Là, on analyse beaucoup mieux les processus biologique, technique et culturel qui fabriquent le virus et qui le mondialisent. Et on se rend donc compte que si on avait développé l’éthologie, ça nous aurait peut-être permis de limiter l’épidémie.
En nous renvoyant à notre propre fragilité humaine, le Coronavirus bouleverse peut-être aussi notre rapport à la mort : peut-il ouvrir à un regain de spiritualité, selon vous ?
La mort fait partie de la condition humaine. Tout comme la spiritualité, d’ailleurs, puisqu’on parle et qu’on est doué d’une capacité de représentation. Pour autant, je suis sceptique sur la nature « spirituelle » de ce qui va suivre. Je parlerais plutôt d’un regain de « spiritualisme », plus proche des fanatismes, religieux ou politiques.
Après de telles catastrophes, on voit souvent s’opérer une flambée du religieux. J’ai pu le constater à Haïti après le tremblement de terre, ou en Colombie après la guerre avec les Farcs. L’angoisse pousse les foules à se soumettre à une autorité suprême pour chercher une forme d’apaisement, avec un comportement expiatoire. Encore une fois, s’il y aura forcément des changements, il ne faut surtout pas croire qu’ils seront forcément pour le mieux…
Ne croyez-vous pas, par exemple, que la triste situation actuelle dans les EHPAD peut nous amener à reconsidérer la place de nos aînés dans notre société ?
J’espère qu’il y aura ce changement de regard, mais je ne suis pas sûr. La vieillesse est un phénomène relativement nouveau, c’est la première fois qu’elle existe de manière aussi longue. En milieu naturel, chez les animaux, il n’y a pas vraiment de vieux : à la première défaillance, ils se font éliminer. Et c’est ce qu’il se passait dans la condition humaine, il y a encore quelques générations… On a donc vu apparaître la vieillesse, en très peu de temps. Aujourd’hui, dans les pays riches, les femmes approchent les 100 ans, et les hommes, les 90 ! La vieillesse vient de naître, d’une certaine façon.
Or cette vieillesse n’a aucune fonction de productivité, elle est vue comme un frein au sprint commercial et capitaliste. Les vieux sont des charges sociales, des poids pour la famille, et c’est pour cela que les EHPAD se sont rapidement développés. En fait, avant le confinement généralisé, on faisait déjà un confinement de vieux, qui tiennent par de minuscules fils affectifs – un coup de téléphone ou une visite de temps en temps. Et si ces visites sont interrompues, ils se laissent mourir : c’est ce qu’on appelle le syndrome du glissement, où les vieux se laissent mourir sans s’en rendre compte… On parle alors de mort naturelle, alors que c’est de carence affective. C’est en tout cas, effectivement, l’un des enjeux du « monde d’après » : il faut inventer un nouveau statut à la vieillesse dans nos sociétés.
Retrouvez la 1re partie de cet entretien :
> Boris Cyrulnik : Retrouver l’art de la simplicité