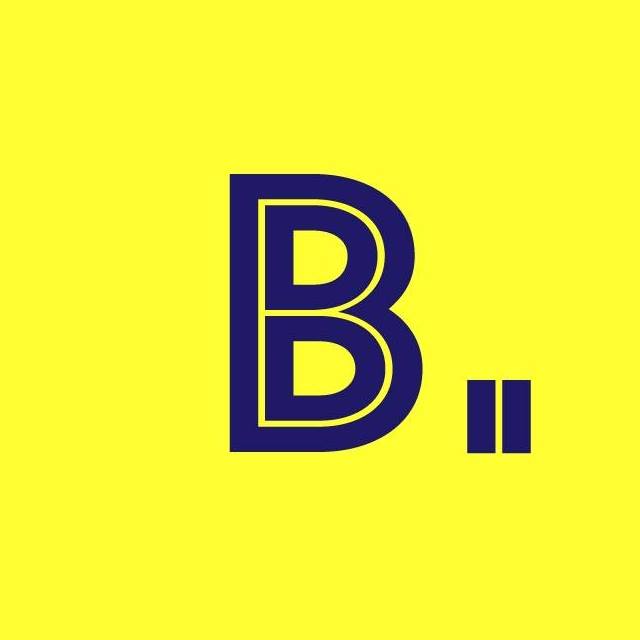« Mer, rien qu’un ruban – bien exiguë l’unique fenêtre. » D’un trait de plume, le poète trace une perspective. Une façon pour Hôsai de s’évader de cette existence qui lui joua bien des tours. Si, aujourd’hui, le célèbre haïkiste de l’ère Meiji a une place à part dans le cœur des Japonais, il n’en fut pas toujours ainsi. Quel étrange destin que celui de ce poète un rien maudit qui prit pour nom de plume Hôsai (« celui qui a lâché prise »).
Né en 1885 aux abords de Kyoto, dans une famille respectable qui l’initie à la philosophie taoïste, Ozaki Shuyu de son vrai nom est promis à une riche carrière littéraire. Ses débuts sont flamboyants : à 15 ans, il fonde le club de poésie Kinzei (« Persil et bourse à pasteur »), rencontre Ogiwara Seisensui, pionnier du haïku en vers libre, avec qui il contribue à sortir ces courts poèmes du carcan d’alors. Rejet de la métrique, du mot de saison obligatoire, de la césure… Sous leurs coups de pinceau minimalistes, le genre se révolutionne pour s’éloigner du maniérisme littéraire et toucher plus directement, plus sûrement, le cœur des hommes. Le sien va être irrémédiablement brisé : à l’âge 21 ans, Ozaki tombe amoureux de sa cousine Yoshie, mais son frère, après avoir donné son consentement, se rétracte et s’oppose au mariage. Un crève-cœur pour le jeune homme désabusé, qui dès lors, sombre dans l’alcool (addiction au saké, « cette chose qui chasse les soucis ») et devient moine mendiant laïc.
« Mer, rien qu’un ruban – bien exiguë l’unique fenêtre. »
À l’hiver de sa vie, il s’exile à Nangô-an, un ermitage situé sur l’île de Shôdoshima, dans la Mer intérieure, pour finir ses jours, loin des hommes : « Si je devais quitter cet ermitage, je renoncerais à me nourrir afin de précipiter ma mort… La société des hommes me répugne, je veux mourir au milieu de la nature, tout seul, dans le silence. » C’est là, pourtant, qu’il écrit ses derniers haïkus, les plus simples, les plus bruts, les plus crus et profonds à la fois. Amoureux de la nature jusque dans ses aspects les plus anodins (« Dans le champ voisin, des poireaux sous la pluie »), Hôsai l’illustre sans chercher à la magnifier, sans bavardage, fuyant les métaphores et les figures de style. La seule contemplation suffit à en révéler toute la beauté, la main de l’homme comme la plume du poète doivent s’effacer au risque de la gâter. À travers ses haïkus de l’instant, « celui qui a lâché prise » guette l’évanescence de chaque chose, tout en disqualifiant, pour un temps, leur issue fatale. Ce recueil, accompagné de quelques notes de l’auteur sur les derniers mois de sa vie, s’apparente aux mémoires du poète du moindre mot (« Une poitrine superbe et là, un moustique »). Il décède le 7 avril 1926, à l’âge de 41 ans, sous le nom bouddhiste de Hôsai Taiku Koji (« Hôsai le laïc Grand Vide »).
L’éditeur a confié les illustrations de cet ouvrage à Manda, spécialiste du Sumi-e (mouvement de peintres japonais, caractérisé par l’usage du lavis à l’encre noire, et proche du bouddhisme zen) et du Haïga (style de peinture japonaise incorporant l’esthétique du haïku). Résidant en Alsace, ce peintre et calligraphe est l’un des rares Occidentaux à avoir reçu, en 2007, l’Ordre du Soleil Levant – Rayon d’Or et d’Argent (l’équivalent de Chevalier des Arts et des Lettres). Planches monochromes, illustrations à minima, mise en page d’une élégante sobriété… Manda chemine avec grâce et retenue dans les pas d’Hôsai pour graver ces instants intemporels