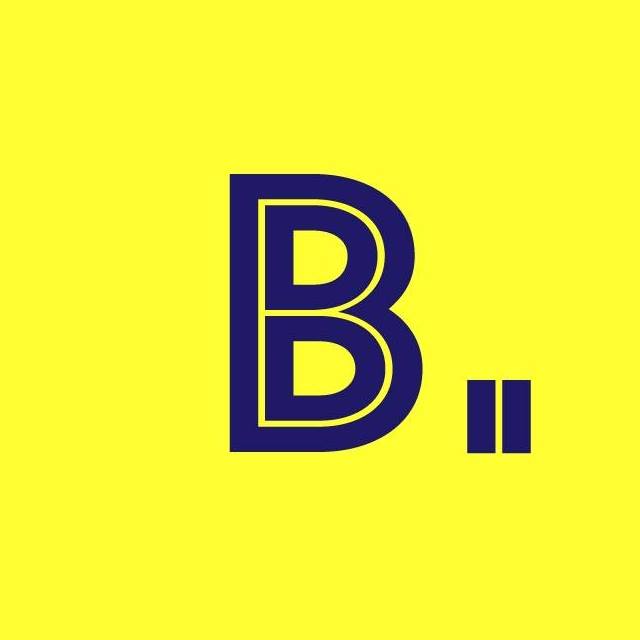À l’image de Thich Nhat Hanh, les bouddhistes ont souvent œuvré dans la lutte contre le sida. Le maître vietnamien a notamment préconisé la constitution de groupes au sein de chaque communauté religieuse pour discuter des dangers de cette pandémie, de la souffrance qu’elle engendre, de la manière de soutenir malades et proches. Est-ce pour vous une aide importante ?
Les religions ont une véritable influence sur leurs fidèles, il est donc essentiel qu’elles se mobilisent contre le VIH, car il ne s’agit pas d’un virus comme les autres ; il touche à la sexualité, à l’usage de drogues et reste mortel dans les pays qui n’accèdent pas aux traitements. En Afrique, où de nombreuses populations sont très touchées par ce fléau, il a été crucial que certains prêtres et sœurs catholiques osent parler du préservatif et défendre l’idée qu’il fallait les utiliser pour préserver la vie et endiguer ainsi sa progression, et ce contrairement à ce que leur imposait leur hiérarchie. Il y a moins de jugement dans le bouddhisme que dans d’autres religions. Dès le début de l’épidémie dans les années 80, les bouddhistes ont fait preuve de bienveillance envers les malades, sans stigmatiser le comportement ou les orientations sexuelles des personnes atteintes du VIH. En Afrique, en Asie et aussi parfois chez nous, ce sont souvent des populations vulnérables et rejetées du fait de leur sexualité. Pour moi, la bienveillance, le respect de l’autre, le refus de catégoriser l’autre et les méchants des gentils…permettent d’œuvrer ensemble pour le bien de tous.
Thich Nhat Hanh a également expliqué que la pleine conscience permettait aux malades de mieux accepter la maladie et ainsi de moins en souffrir.
C’est une évidence ! Cette idée s’applique non seulement au sida, mais aussi à toutes les maladies. Certaines personnes ont tendance à faire la politique de l’autruche, à être dans le déni, quand elles apprennent qu’elles sont malades, surtout si cela peut être grave. À mes yeux, il est plus utile d’affronter les choses. On l’a souvent remarqué : ce sont les personnes qui assument leurs pathologies qui se défendent le mieux ! Cette notion du moment présent est donc fondamentale pour y parvenir. Mais elle est de plus en plus compliquée à vivre dans les sociétés occidentales, où nous sommes sans cesse mis sous pression, où l’on nous pousse à nous projeter, à penser à ce que nous ferons dans six mois… Mais où serons-nous dans six mois !? Vivre dans le moment présent est la meilleure chose à faire lorsqu’on est atteint d’une maladie mortelle.
Vous rejoignez là les enseignements des maîtres qui expliquent que le bouddhisme est une confrontation sans concession à la réalité, même si cela est compliqué à appliquer au quotidien.
En effet, se confronter à la réalité est le seul moyen de vivre vraiment, car quand on fuit les problèmes, ils reviennent. Quand j’ai appris ma séropositivité en 1987, à l’âge de 28 ans, cette nouvelle a sonné comme un arrêt de mort ! Que faire après une telle annonce ? Cela m’a paru évident : je suis simplement retourné à mon travail d’assistant parlementaire. J’ai continué à vivre, à avoir une vie sociale – certes différente du fait de la maladie – et surtout, je me suis occupé des autres. D’une certaine manière, j’ai oublié ma propre maladie à partir du moment où je me suis occupé des autres. À l’époque, autour de moi, c’était une véritable hécatombe… J’ai pu ainsi constater que, très souvent, ce sont les gens qui souffrent de pathologies graves et qui l’assument qui s’en sortent. On ne peut pas généraliser, mais le fait de ne pas avoir peur de la maladie, de ne pas en avoir honte d’en parler – une maladie n’est jamais honteuse ! – et de faire attention aux autres, change le regard que l’on porte sur soi et sur la maladie. Ce qui aide à aller mieux.
Finalement, cette confrontation à la mort vous a donné le goût de vivre et celui des autres…
Paradoxalement, ce virus a été une chance ! Quand on apprend qu’on va peut-être mourir dans les mois qui suivent, soit on s’effondre, soit on choisit de vivre. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de cette notion du moment présent, qui me parlait depuis très longtemps, mais que je ne pratiquais pas : profiter du moment, car il n’y aura peut-être pas de lendemain… J’ai aussi appris à mieux aimer les autres, à leur prêter plus d’attention, parce que j’ai compris que tout est éphémère. Le sujet de la mort, de la fin de vie, est tabou en Occident : on a parfois l’impression que certaines personnes ne savent même pas qu’elles vont mourir ! Elles courent toujours plus vite, dans tous les sens et se rendent compte, dans les derniers instants, qu’elles n’ont pas vécu. La vie, c’est d’abord ce que l’on construit avec les autres.
À ce sujet, le Dalaï-Lama a déclaré que « dans certains cas, exceptionnels, l’euthanasie peut être un recours. Si les circonstances sont telles que le malade se trouve dans un coma dont il ne sortira pas, qu’il est maintenu en vie artificiellement, et que la famille doit faire face à de grandes difficultés matérielles afin de prolonger cet état, l’euthanasie est alors envisageable. » Qu’en pensez-vous ?
C’est une étape. On entend rarement cette parole chez les religieux, excepté chez les protestants. Les religions ont plutôt tendance à dire que la souffrance est rédemptrice… Certes, elle peut aider à avancer d’une certaine manière, mais rien ne devrait nous obliger à la vivre quand, dans les derniers moments de vie, elle ne permet plus aux malades de vivre décemment, voire qui les rendent odieux, car les douleurs physique et psychique sont insupportables.
« Une mort choisie est une mort consciente. »
Ma réflexion sur ce sujet trouve sa source dans mes expériences personnelles. J’ai vu tellement de jeunes mourir dans de grandes souffrances alors qu’ils demandaient à ce que l’on cesse l’acharnement thérapeutique, et qu’on ne les entendait pas. C’est intolérable ! Je le répète : rien ne nous oblige quand la fin est imminente à devoir mourir dans de si grandes souffrances.
Chaque religion a une approche spécifique de ce moment particulier de la fin de vie et de la mort. Ce droit de mourir dans la dignité que vous défendez doit-il prendre en compte le discours religieux ou, au contraire, ne s’exercer que dans un cadre laïc ?
Les religions ont évidemment leur mot à dire dans ce débat. Laïc ne veut pas dire qu’on exclut les religions, mais que ce ne sont pas elles qui édictent les lois. Elles ne doivent pas imposer leur point de vue, c’est ce que ne comprennent pas certains évêques, comme le cardinal Barbarin. Je ne suis pas un militant de l’euthanasie, je suis un militant de la liberté et du choix ! Je souhaite qu’on écoute et qu’on prenne en compte toutes les opinions : le choix d’une personne qui souhaiterait vivre le plus longtemps possible, quitte à ce que ce soit dans la souffrance, doit être respecté. À l’inverse, quand un malade estime que ses souffrances n’ont plus de sens, là aussi, nous devons l’écouter. Il faut donc une loi qui pose un cadre général pour protéger les plus faibles, sur lequel on puisse réfléchir ensuite au cas par cas.
Vous défendez le droit de mourir dans la dignité. Les bouddhistes tibétains, eux, considèrent que le dernier moment juste avant de mourir, la dernière pensée, est un moment essentiel pour se libérer de tout ce qu’on a vécu de négatif et, idéalement, pour renaître dans de meilleures conditions. Qu’en pensez-vous ?
Cela n’a rien d’incompatible : une mort choisie est une mort consciente ! La majorité des gens meurent la nuit, seuls à l’hôpital, si rien n’a été fait avant, ils s’enfoncent sans avoir pu parler à leurs proches. Ce n’est pas le meilleur moyen pour mourir en étant en paix avec soi-même. D’autant que dans ces moments de fin de vie, il y a souvent beaucoup de points à régler, des non-dits, des paroles à dire… Quand on choisit le moment de mourir, cela permet non seulement de préparer ceux qui nous entourent et de leur laisser ainsi de beaux souvenirs et aussi de faire le bilan de sa vie pour partir en paix. Je précise que s’engager dans une euthanasie ou un suicide assisté ne se fait pas en deux jours ! Il y a tout un processus à suivre et un délai à respecter – un mois en Belgique par exemple -, qui permet de mener une véritable réflexion. Voilà pourquoi je pense que les morts choisies sont les plus conscientes.