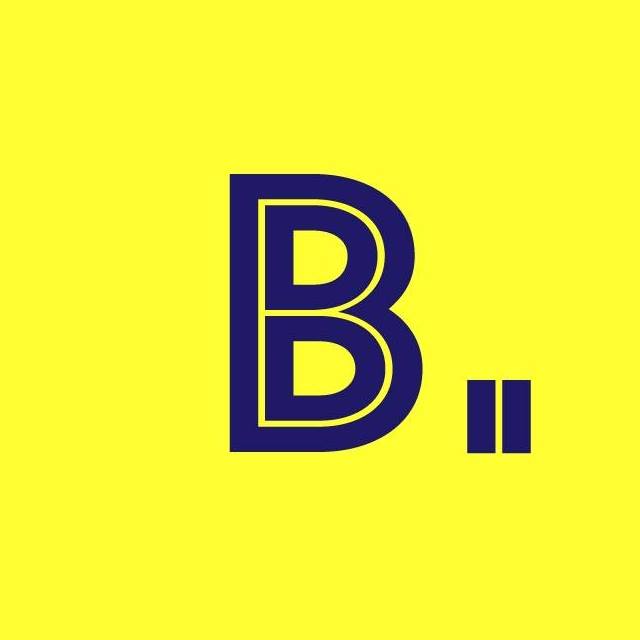Bouddha News.
Une approche moderne et humaniste du bouddhisme pour construire une société plus consciente, solidaire et éthique.
Des informations actuelles et novatrices sur le bouddhisme
Des perspectives différentes sur l’altruisme, la compassion, la bienveillance et l’environnement
Une communauté de contributeurs engagés pour créer une société plus équitable et plus juste
Une seule bougie peut en allumer des milliers, et la durée de vie de la bougie n’en sera pas écourtée. Le bonheur n’est jamais diminué du fait d’être partagé.
– Le Bouddha
La newsletter de Bouddha News.
Pour recevoir nos derniers articles directement dans votre boîte mail.
Qui sommes-nous ?
Nous croyons que le bouddhisme peut offrir des solutions aux problèmes contemporains et nous voulons partager des pistes de réflexion novatrices et actuelles. Nous sommes convaincus que nous devons tous travailler ensemble pour créer une société plus juste et plus équitable.
Sur Bouddha News, vous trouverez des articles, des interviews, des reportages et des réflexions qui vous aideront à construire une réflexion personnelle éclairée et à vous sentir plus connecté à la vérité.
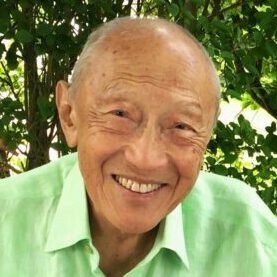
« Méfie-toi des pensées négatives, car elles s’attaquent au corps et à l’esprit. Elles sont les premiers symptômes du mal. Guéris ton esprit si tu veux guérir ton corps. »
– Vénérable Dagpo Rinpoché
Vos questions
Contactez-nous pour partager vos réflexions, vos questions et vos points de vue sur le bouddhisme.
Nos articles à la une

Quelles sont les pratiques alimentaires des moines bouddhistes ?

La méditation, un complément aux traitements psychiatriques traditionnels

Les fondements du bouddhisme : enseignements, croyances et pratiques

Le bouddhisme en Belgique : vers une reconnaissance officielle

Pourquoi les non-bouddhistes se font faire des tatouages du Bouddha ?